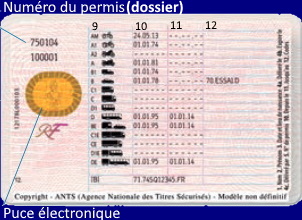Les
documents d'évaluations et de délivrances
provisoires et définitives ont évolué.
|
Qui a
passé son
permis avant les années 80 et ne
reconnaît pas sa
«feuille rose» des années
S.N.E.P.C. ?
|
S'en
suivait un permis définitif trois volets grand format.
|
 |
 |
Déjà,
depuis quelques
années (à partir des catastrophiques
années
meurtrières - dont le pic a été
en 1972-) de multiples
méthodes et procédures d'évaluations
successives,
avec des harmonisations nationales ont vu le jour rendant les
épreuves beaucoup plus objectives et adaptées
à la
circulation et aux réseaux croissants (en
complément des actions «Bison
futé
à partir de 76»).
Seul le
verso du dossier
d'inscription
(de demande de permis) contenait alors
des
informations quant au bilan des épreuves. Toutefois, jusque
dans les années 2000 le résultat
n'était pas
différé et l'inspecteur annonçait
celui-ci avec
les éventuelles causes d'ajournement ou conseils au
candidat.
|
Les candidats
s'inscrivaient alors sur un dossier papier (pas d'internet)
DOSSIER
D'INSCRIPTION (Cerfa 02) |
Et les
résultats étaient portés, par
l'inspecteur, au verso, avec mention des lettres code
correspondant aux
thèmes des erreurs,
Puis en conduite avec des codes souvent
incompréhensibles
pour la plupart des usagers, indiquant la ou les raisons de
l'ajournement.
On notera la présence d'un timbre fiscal dans la case
prévue
jusque
dans les années 80.
Bien sûr, les mentions écrites étaient
manuscrites et renseignées à bord du
véhicule.
|
Vinrent
ensuite les
résultats, toujours au verso :
- pour le
code, par un ticket sorti d'une imprimante (voir page code)
- et pour la
conduite, par la transcription des différentes
feuilles de
notation puis des bilans de compétences qui firent l'objet
de feuilles annexées. (ci-dessous). |
Cliquez sur le
document
pour agrandir dans une autre fenêtre

|
Cliquez sur le
document
pour agrandir dans une autre fenêtre

|
Cliquez sur le
document
pour agrandir dans une autre fenêtre

|
Les
années 80
:
|
|
Pour les
«moins vieux»
il y
a eu la feuille rose DSCR
(on
remarquera la
mention «Inspectrice")
|
Et
le
«trois volets» type
dit européen
(harmonisation européenne de 1985) |
Comportant
les
mentions des catégories de permis du moment
(celui-ci
était le mien avec les tampons
de validité pour toutes les catégories) |
 |
 |
 |
|
.
Dans
ces
années 80, des feuilles de notations puis des
«bilans de
compétences» ont commencé
à
être
utilisés
pour rendre le résultat plus compréhensible par
les candidats.
|
Avec la
première procédure
d'évaluation,
est
arrivée la première feuille de notation
|
Les
statistiques étaient collectées sur des
états papier (P1, P2, T1 et T2 renseignés par les
inspecteurs, après la séance ou la
journée d'examens pour
être transmis à la hiérarchie qui
vérifiait et transmettait au service national.
On peut dire
que c'était le début du système
d'information (S.I.) dans ce domaine.
Mais les années 80 ont été aussi la
période où on a commencé à
s'intéresser encore plus aux statistiques.
Le PC
n'était pas encore un outil grand public mais le
minitel était en pleine vogue, on le verra sur le
chapitre «code» (langage courant pour
désigner l'épreuve
théorique générale -E.T.G.-
).
Le minitel s'est donc substitué durant deux
décennies aux états papier
et les inspecteurs devaient chaque jour transmettre les statistiques
par cette voie télématique.
Quel que soit le support, le dossier (cerfa 02) était
renseigné et, en cas de réussite, la feuille rose
était
encore délivrée comme permis provisoire
immédiatement après
une épreuve pratique
favorable.
|
Son
équivalent mécanographié
(perforée)
La Fiche de notation mécanographique |
Cliquez sur le
document
pour agrandir dans une autre fenêtre

Des
procédures écrites par le SNEPC
apparaissent et permettent de qualifier et quantifier les
erreurs suivant
leur importance et aussi de noter l'ensemble de la prestation par un
décompte manuel des points comme vous pouvez le voir dans
les colonnes de droite. Il fallait atteindre la note de 120/200 pour
obtenir son épreuve de conduite.
Évidemment,
vous l'aurez compris, les zones rouges
correspondaient à des erreurs
éliminatoires.
Ces
procédures ont fait l'objet de guides
à
destination
des inspecteurs, bien sûr, mais aussi d'autres,
spécifiques à l'intention des enseignants pour
que
le langage, les exigences et les pratiques puissent
être
connues et respectées par tous.
|
Cliquez sur le
document
pour agrandir dans une autre fenêtre

Les feuilles de
notation ont donc
été
adaptées au système de mécanographie
(cartes perforées).
Vous retrouvez les mêmes rubriques , mêmes
critères, même système de
notation sur la carte perforée de droite que sur la
feuille de notation de gauche.
L'utilisation n'était pas aisée avec un
boîtier
et un stylo/stylet spécifique pour cocher et/ou perforer
cette carte.
Exemples d'utilisation sur la page
code
après 1972
Vous
y
trouverez également le principe de fonctionnement et
l'utilisation qui était faite de la
"mécanographie"
- descendante des métiers à tisser et
prémices de l'informatique moderne.
|
En
1984,
le
SNEPC est dissout. Il est créée une
sous-direction
de la formation du conducteur et un Service de la Formation du
Conducteur (DSCR / SFC), parallèlement aux lois de
titularisation de l'époque. La carte professionnelle de
l'inspecteur (trice) change.
(carte
professionnelle ci-contre - statut encore contractuel -
contrat renouvelable une fois).
=>
|
 |
En
gestation
depuis 1984,
le Plan National de Formation P.N.F. a permis, à partir de
1989, d'harmoniser mieux encore la
formation grâce à une pédagogie par
objectifs. Il sera ensuite
décliné pour
chaque catégorie de permis
Il est remplacé par le Référentiel
pour
l'Éducation à une Mobilité Citoyenne
(REMC),
basé sur la matrice GDE (Goals for Driver
Éducation).
C'est une approche hiérarchique qui
permet d'assimiler les compétences
nécessaires pour
conduire.
Il a été élaboré en 1999
au cours d'un travail de collaboration européenne.
On remarquera sur la photo la déclinaison du livret pour
l'AAC.
En effet, l'Apprentissage anticipé de la conduite, AAC,
auparavant appelée conduite accompagnée, est une
formation française existant depuis 1987 et permettant
d'acquérir de l'expérience avant l'âge
légal du permis. |
 |
Avant l'ère
du tout numérique,
les balbutiements de
l'informatique
|
  |
Entre
1990 et 2000,
les
résultats d'une part et la gestion du travail d'autre part
se
sont appuyés sur les techniques alors devenues les outils du
quotidien des entreprises.
Puis, les encadrants ont disposé des premiers PC, souvent
équipés des systèmes d'exploitations
d'abord
rudimentaires (DOS puis les premiers windows) pour gérer les
équipes et les plannings puis de leur
côté, les
inspecteurs recevaient ceux-ci et transmettaient les
résultats
par minitel via le réseau Transpac (pas encore
d'internet
même bas débit).
|

Tous ces dispositifs
communiquant avec "le grand
ordinateur" :
le DPS 7000 de la capitale. |
|
1992 :
Institution
du permis à 12 points avec une
spécificité
française qui consiste en la possibilité d'en récupérer
moyennant le suivi d'un stage de
sécurité routière.
Années
2000 à 2020 |
Du
côté de l'éducation nationale,
les
cartes de
jeunes conducteurs et les brevets de sécurité
routière se sont transformés, autant par la forme
que le
contenu du fond pour faire place aux APER
et ASSR1 et 2
(attestations scolaires de sécurité
routière
entrant pleinement dans le continum éducatif.
|

Cette mise place a
été longue et
il a fallu des
moyens et
mesures transitoires au moment où ces documents sont devenus
indispensables pour s'inscrire au permis . C'est pourquoi des
organismes ont permis à ceux qui n'avaient pas pu obtenir
ces
validations pendant leur scolarité, de le suivre
après ce
cursus. Les Attestations correspondent à chaque
niveau ou
comme à droite, l'ASR (ASSR de substitution).
Le détenteur se voit délivrer une attestation et
une carte
personnelle (ASSR deux niveaux au verso).
|

|
Loi
n°
2013-595 du 8 juillet 2013
Afin d'acquérir des comportements qui permettent de se
protéger des dangers de la circulation et de tenir compte
des
autres usagers de l'espace routier, la mise en place d'une
éducation à la sécurité
routière
nécessite, dès le plus jeune âge, de
prendre
conscience des règles de sécurité et
identifier
les risques et les comportements à adopter.
L’éducation à la
sécurité
routière est donc jalonnée de ces
différentes attestations
validant
les compétences acquises ou en voie d’acquisition. |
 |
 |
|
Revenons au permis :
A partir de
2000, suite à des
agressions
à l'encontre
d'inspecteurs après des ajournements non compris
ou contestés, des essais ont
été entrepris dans
plusieurs départements pour porter connaissance du
résultat en différé
(par courrier). Cette mesure étendue d'abord en 2002
à quelques autres départements au fur et
à mesure que telle ou telle agression se produisait,
fut progressivement adoptée sur tout le territoire
pour être généralisée
à toutes les épreuves
théoriques et pratiques désormais depuis 2013.
Il fallait donc en parallèle, à la fois
pour permettre de contribuer à améliorer
la formation ou le complément de celle-ci, en cas
d'ajournement, mais aussi permettre au candidat, seul ou
accompagné de son enseignant, de
comprendre et interpréter les raisons de son ajournement en
cas d'échec. De plus, ce bilan permettait de
connaître les
points faibles à améliorer, en cas de
réussite.
Aussi pendant les années qui ont suivi, des documents ont
été
envoyés par courrier pour annoncer et motiver le
résultat à l'épreuve et ils n'ont
cessé de s'améliorer. C'est aussi la fin d'une
expression longtemps entendue pour désigner le Certificat
Provisoire d'Examen du Permis de Conduire (CEPC) ou encore
Modèle H,
administrativement, (MleH) :
«ma
feuille rose",
(dans un premier temps
d'ailleurs, devenue jaune).
|
En fonction des noms
des ministères
de tutelle deux formes différentes
( il y avait un
troisième volet pour l'archive de l'établissement
d'enseignement - visible en partie basse de l'agrandissement )
|
Puis
ce
fut un autre
changement, le «bilan de
compétences» détaillant
encore plus les différentes phases de
la conduite du candidat au cours de son épreuve. |
Cliquez sur le
document
pour agrandir dans une autre fenêtre

|
Cliquez
sur le document pour agrandir dans une autre fenêtre

|
La percée du
numérique
|
L'an
2000
a
été une année charnière et
commençant par la déconcentration du service de
la
formation du conducteur vers les directions départementales
de
l'équipement puis des territoires, on utilise
d'ailleurs depuis, le nom d'Éducation
Routière
(toujours pilotée par un ministère de tutelle en
fonction
des orientations gouvernementales : Ministère des
transports, du
développement durable puis au Ministère de
l'Intérieur), puis le début d'une
révolution technique des épreuves.
Les
cartes
professionnelles des inspecteurs (trices) sont
alors
d'une autre matière, ont un format désormais
standard
dit "carte bancaire" et bien sûr sont à puce
=>
|
  |
2004 :
Institution
du permis "probatoire" à
points limités pour les nouveaux conducteurs.
2004 :
Modification importante des conditions de passage et du contenu, en
particulier avec
introduction de notions comportementales dans
l'épreuve théorique (code) avec supports
informatiques, sur tout le territoire après
expérimentations dans certains départements
pilotes.
De
nouveaux bilans chiffrés, ayant valeur de certificat
provisoire de conduite, ont d'abord
été conçus sur papier (identiques
à la photo de droite ci-dessous),
Ils ont ensuite
été transposés sur
écrans. L'ère
du numérique
était arrivée.
|


























 Apparaît
alors la
première version dite «trois
volets» avec,
Apparaît
alors la
première version dite «trois
volets» avec,